- VOILIERS
- VOILIERSAutrefois pratiquée par une minorité très restreinte, composée de fanatiques désintéressés, ou de riches snobs, la voile est aujourd’hui une activité très populaire.Elle s’est démocratisée grâce à l’avènement des constructions en série, réalisées en matériaux plastiques, dont la baisse des coûts de production permet au plus grand nombre d’acquérir le bateau de son choix.L’industrie nautique est ainsi passée de l’artisanat au stade industriel avec des sociétés d’envergure internationale comme Bénéteau ou Jeanneau.C’est ainsi que le passé historique et légendaire de la navigation à voile a créé un engouement qui a maintenant atteint toute une partie du public avide de trouver en mer une satisfaction à ses besoins de liberté, d’isolement ou de communion avec la nature.En remontant dans le passé, les premières représentations de bateaux à voile, telles que nous les connaissons actuellement, sont égyptiennes, sans toutefois que l’on puisse en déduire que les Égyptiens en aient été les créateurs.La force du vent a été utilisée, à l’origine, comme auxiliaire de la rame pour la propulsion des navires par vent arrière, ou vent portant, et on a longtemps pensé que les voiles rectangulaires ou «carrées» des navires antiques permettaient seulement de naviguer par vent arrière. Mais les marins ont dû très tôt constater qu’un changement dans l’orientation de ces voiles pouvait procurer une certaine force propulsive, même lorsque le vent atteignait le navire par l’avant du travers. Et certains documents montrent clairement une orientation de cette voile, permettant de naviguer à diverses allures, et peut-être de louvoyer (photo 1).Les historiens situent aux environs du IXe siècle de notre ère l’invention des voiles latines, de forme triangulaire, facilement orientables au voisinage du plan longitudinal du navire, et donc plus efficaces que les voiles rectangulaires, pour la remontée au vent à l’allure du plus près.La voile latine, par des modifications et des arrangements successifs, a donné naissance à la voile au tiers, puis à la voile aurique et, enfin, à la voile bermudienne ou marconi adoptée par tous les voiliers actuels. Les focs, également orientables dans l’axe du navire, ont dû apparaître à la même époque que les voiles latines. La voile à livarde dérive à la fois de la voile rectangulaire et de la voile latine.Au cours des siècles, les navires, selon leur destination et les exigences de leur navigation, ont utilisé soit les voiles carrées, soit les voiles latines, soit le plus souvent une combinaison des deux. On dit avec raison que le XIXe siècle marque l’apogée de la navigation à voile. Parmi les voiliers les plus célèbres de cette époque, citons les clippers, les bateaux-pilotes et les goélettes de pêche.Les clippers étaient destinés aux grands voyages océaniques intercontinentaux, lorsque le profit commercial dépendait surtout de la vitesse. Les clippers, dont la voilure était composée principalement de voiles carrées ou square sails (photo 2), utilisaient autant que possible les vents portants, en choisissant pour cela les routes les plus favorables.Les bateaux-pilotes, petites unités conduites par des équipages réduits, utilisaient toujours des voiles auriques ou latines (fore and aft sails ), pour être aisément maîtres de leur route quelle que soit la direction du vent. Les bateaux-pilotes ont été les principaux modèles de nos yachts à voile actuels. Par exemple, la célèbre America n’était autre qu’un bateau-pilote du port de New York adapté à la navigation de plaisance (photo 3).Les goélettes de pêche, en particulier celles de la côte nord-est des États-Unis et du Canada, ont d’abord servi de modèles aux grands yachts à voile, puis, plus récemment, elles ont imité les derniers perfectionnements des yachts. Comme pour les clippers, la vitesse était un élément déterminant de profit commercial pour les bateaux-pilotes et les goélettes de pêche. Ces dernières étaient gréées avec deux mâts, des voiles à cornes, un fisherman et munies à l’avant d’un grand bout-dehors et de deux ou trois focs.1. L’architecture du voilierLe dessin de la coqueLa définition de la surface de la coque d’un voilier est l’une des tâches les plus nobles et les plus délicates de l’architecte naval. Si les méthodes de définition de cette surface ont évolué au cours des siècles, il faut noter que presque toutes sont encore en usage de par le monde.Une méthode primitive de conception et de construction des voiliers consiste à réaliser, sans aucun plan, une charpente constituée de la pièce de quille et de quelques couples transversaux, sur lesquels le charpentier place quelques bordés longitudinaux; ensuite, par tâtonnements, il corrige, rectifie et fait «filer» sa coque. C’est un procédé couramment employé pour la construction des bateaux de pêche.Une autre méthode, très utilisée encore au XIXe siècle par les constructeurs de navires – et pratiquée également par de célèbres architectes américains –, est la réalisation de modèles réduits, coque ou demi-coque, pour donner une image tridimensionnelle exacte de la carène. Un relevé de cotes, à partir de cette maquette, permet ensuite de fournir un plan au constructeur. Cette méthode, qui exige beaucoup d’habileté, a produit des carènes magnifiques et performantes, comme celles des goélettes de pêche américaines et canadiennes et celles de certains défendeurs de l’America’s Cup, ou Coupe de l’America.Aujourd’hui, la plupart des architectes dessinent complètement leurs coques avant la construction. Deux méthodes prédominent: le tracé manuel et la conception assistée par ordinateur.Dans l’option traditionnelle, l’architecte dessine des projections et des intersections de la surface de la carène avec des plans orthogonaux horizontaux, verticaux et longitudinaux. Elles constituent le plan des formes à une échelle convenue. Puis les cotes de ce plan sont relevées et indiquées sur un document appelé «devis de tracé», document utilisé alors pour reproduire le plan des formes en grandeur réelle.La conception assistée par ordinateur remplace progressivement la méthode manuelle. La carène y est découpée en un grand nombre de petites surfaces, chacune étant représentée par son équation tridimensionnelle. Toutes ces surfaces sont raccordées avec un degré de continuité élevé pour obtenir une surface globale lisse et passant par des points ou des courbes choisis par le concepteur. Cette représentation tridimensionnelle de la carène constitue ensuite une base de données accessible par de multiples programmes utilitaires pour calculer des surfaces, des volumes, des inerties, ou bien pour y implanter les tracés des aménagements.Tous ces procédés ont en commun l’absence de critère d’évaluation parfaitement objectif de la qualité de la conception. ColinArcher, John Scott Russel et Alfred Turner, entre autres, ont développé des méthodes semi-empiriques de tracé des carènes. Aucune n’a reçu de l’expérience, ou de la théorie, une confirmation complète. D’un point de vue scientifique, on dispose depuis le milieu des années 1980 de logiciels d’hydrodynamique capables de prévoir et de calculer l’écoulement en présence de la surface libre. Par exemple, le programme REVA, développé par la société Sirehna etl’école centrale de Nantes (E.C.N.), calcule le champ de vagues, sous certaines hypothèses, autour d’une carène de voilier. L’architecte dispose ainsi d’outils sophistiqués qui lui permettent de guider ses choix et de sélectionner les meilleures solutions. Il peut aussi utiliser des essais en bassin des carènes sur maquettes. L’architecte doit aujourd’hui disposer de bonnes connaissances scientifiques pour retenir les meilleures méthodes numériques et expérimentales, interpréter les résultats, les confronter à son expérience et choisir, in fine, le meilleur compromis.Le dessin des voiliers monocoques modernes a longtemps été influencé par les impératifs de la jauge I.O.R. (international offshore rule ). Celle-ci est aujourd’hui en régression, supplantée, pour les voiliers de compétition, par de nouveaux systèmes de handicap comme la jauge I.M.S. (international measurement system ). Des jauges spécifiques propres à certaines courses connaissent aussi un grand succès comme la jauge du W.O.R. (whitbread offshore rule ) pour la course autour du monde en équipage ou la Class America pour la Coupe de l’America. Par souci d’économie, beaucoup d’amateurs préfèrent des courses en monotype, où les bateaux sont tous identiques. Quant aux yachts de croisière, une très grande variété de formes de carènes existe, certaines sont issues de la course, d’autres sont étudiées pour un volume intérieur maximal ou pour des conditions particulières.Le plan de voilureSouvent un peu négligée, la voilure est pourtant le moteur du voilier. Elle est issue d’un difficile compromis entre la performance, la facilité de manœuvre et l’esthétique. À cela s’ajoutent, pour les bateaux de course, des considérations de jauge.Les voiles sont réparties en général sur un ou deux mâts, eux-mêmes soutenus par un haubanage latéral et longitudinal. La position et l’importance relative des mâts indiquent le «type» du voilier: sloop, cotre, ketch, etc. La technologie moderne a permis en la matière, plus que partout ailleurs, des progrès énormes. Autrefois en coton, trop sensible à l’hygrométrie de l’air, les voiles anciennes étaient très lourdes et perdaient leur forme, et donc très vite leur rendement propulsif. Aujourd’hui, des textiles synthétiques légers, endurants et peu déformables, donnent des voiles de grande longévité et d’un bon rendement.Parallèlement, les magnifiques mais souvent fragiles et complexes gréements d’antan ont cédé la place aux alliages légers et aux aciers inoxydables, voire composites de Kevlar ou de carbone, pour la fabrication des mâts et de leur haubanage.Il en résulte pour tous, coureurs au large ou simples plaisanciers, la possibilité d’envisager, avec une certaine sérénité, l’éventualité d’un mauvais coup de vent sans trop risquer d’avarie de gréement ou de voilure.2. La physique du voilierLa physique du voilier recouvre les allures, la stabilité du voilier, les forces aérodynamiques et hydrodynamiques pour trouver la vitesse et le cap optimaux.Les alluresLe terme «allure», lorsqu’il concerne un navire ou un voilier, sert à définir l’orientation de la route suivie par le bateau par rapport à la direction du vent (fig. 2).La stabilitéIl est permis de dire, par une formule raccourcie très expressive, que la stabilité est la force propulsive du voilier. En effet, un voilier ne peut supporter de surface de voilure, ou ne peut donc disposer de force propulsive, que dans la mesure où sa stabilité le lui permet.La stabilité se mesure et s’exprime par le moment du couple de redressement, c’est-à-dire par le produit du poids du navire multiplié par la distance entre le vecteur poids appliqué au centre de gravité et le vecteur poussée hydrostatique d’Archimède appliqué au centre de carène, c’est-à-dire au centre géométrique du volume immergé. La courbe de redressement du voilier est la courbe des moments de redressement en fonction des différents angles de gîte (inclinaison latérale du voilier). Une même stabilité (c’est-à-dire un même couple de redressement) peut être obtenue par un grand poids et un petit bras de levier (exemple du voilier de commerce ou du yacht monocoque, fig. 3 a et b) ou, au contraire, par un petit poids et un grand bras de levier (exemple du yacht multicoque, catamaran ou trimaran, fig. 4 a et b, 5 a et b.La stabilité d’un voilier est étudiée du double point de vue des performances et de la sécurité. Ainsi, une augmentation de la stabilité aux faibles angles, jusqu’à 300 environ, est un facteur de vitesse aux allures proches du vent; alors que l’augmentation de la stabilité aux grands angles, et jusqu’à 1800, a surtout une influence sur la sécurité dans des conditions de navigation critiques.L’étude de la courbe de redressement d’un voilier est fondamentalement analogue à celle d’un navire quelconque. Selon le type de voilier, on obtient des courbes de redressement très différentes (fig. 6). Plusieurs paramètres les décrivent et parmi ceux-ci principalement l’angle de chavirement statique(angle pour lequel le couple des forces de gravité et d’Archimède s’inverse et devient couple de chavirement). Cet angle peut être de l’ordre de 1200 à 1400 pour les voiliers de plaisance de série à quille lestée. Pour les racers des séries internationales, il arrive quele chavirement statique soit impossible. En outre, l’aire de la partie positive de la courbe des moments de redressement traduit la résistance à l’impact d’une vague ou à celui d’une rafale de vent; alors que l’aire de la partie négative de la courbe (partie grisée, fig. 6) caractérise la stabilité en position chavirée. Cette dernière doit être minimisée pour que l’équilibre en position chavirée soit très instable.Les multicoques, catamarans, trimarans et praos ne sont généralement pas lestés et tirent leur stabilité de leur très grande largeur: leur courbe des moments de redressement passe par un maximum très accentué vers 100-300 pour s’annuler ensuite vers 700-900. Du fait de leurs caractéristiques, ils présentent souvent des stabilités longitudinale ou diagonale voisines de leur stabilité latérale.Pour les monocoques, un accroissement de la gîte a pour conséquence une augmentation de la traînée. D’où l’importance de la stabilité du monocoque aux allures proches du vent où la vitesse maximale, pour un angle de remontée au vent donné, est atteinte à des angles de gîte compris entre 100 et 300.Les forces aérodynamiques et hydrodynamiquesL’origine de l’énergie propulsive d’un voilier est la transformation par les voiles de l’énergie cinétique du vent. On constate expérimentalement que le fluide est accéléré sur une face de la voile et ralenti sur l’autre. D’après le théorème de Bernoulli, ces différences de vitesses induisent des différences de pressions, une surpression au vent et une dépression sous le vent. La résultante de ces pressions constitue la force aérodynamique (fig. 7 a) soit づa , appliquée en un point appelé centre d’effort de la voilure. づa peut être décomposée selon une composante dans la direction du vent apparent づx , qui est la traînée de la voilure, et une composante dans la direction orthogonale au vent apparent づz , qui est la portance de la voilure.Sous l’influence du vent, le voilier se déplace à une vitesse donnée ふs . Il ressent alors un vent relatif en sens opposé 漣 ふs . Le triangle des vitesses (fig. 7 b) montre que le vent apparent ふa est la somme du vent réel ふt et du vent relatif 漣 ふs . Cela signifie qu’à vent réel ふt donné, et à angle de remontée au vent vrai 塚 donné, la vitesse du voilier ふs dépend du seul angle 廓, entre le vent apparent ふa et la route du navire.La finesse de la voilure Fz Fx = cotg 﨎a traduit le rapport de la composante utile, qui est la portance づz , à la composante nuisible, qui est la traînée づx . La projection de la force aérodynamique totale づa sur la direction d’avancement du navire, c’est-à-dire la force づr propulsive disponible, dépend à la fois de la valeur de づa et de son orientation, fonction elle-même de la finesse (fig. 7 a).Pour augmenter cette force propulsive づr , on cherche soit à augmenter la force aérodynamique totale づa , soit à améliorer la finesse. Il n’est malheureusement pas possible d’obtenir simultanément une force aérodynamique et une finesse toutes deux maximales. Compte tenu de l’orientation des forces, on cherche à augmenter la finesse aux allures proches du vent, et, au contraire, à accroître づa aux allures portantes. Sur les voiliers modernes, on obtient une finesse maximale de 4 à 5 et un coefficient de portance maximale de 1,4 à 1,6.Tout engin flottant à propulsion vélique, que ce soit un navire à carène profonde ou un voilier léger glissant près de la surface, transfère une partie de l’énergie fournie par le vent à la masse d’eau qui l’entoure.La carène développe ainsi des efforts hydrodynamiques (fig. 7 a), dont la résultante et le moment sont égaux et opposés à ceux des forces de gravité et des efforts aérodynamiques. En projection, on obtient une résistance à l’avancement ぱ opposée à la composante propulsive づr et une résistance latérale づs opposée à la composante de gîte et dérive づh , et enfin un couple de redressement opposé au couple inclinant. La carène se comporte donc comme un hydrofoil dont l’efficacité sera d’autant plus grande que le rapport Fs R = cot 﨎h , c’est-à-dire la finesse hydrodynamique de la carène, sera plus grand. L’écoulement autour de la carène et les variations concomitantes de pression (qui sont à l’origine des forces hydrodynamiques) sont déjà complexes pour la carène d’un navire de forme symétrique se déplaçant avec une dérive et une gîte nulles; elles deviennent encore plus complexes pour un voilier dont la carène gîtée n’a plus une forme symétrique et avance «en crabe» avec une dérive non nulle.Très schématiquement, la résistance à l’avancement ぱ est la somme des résistances de frottement, de remous, de vagues, de la résistance due à la gîte et de celle qui est induite par la dérive du voilier:
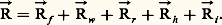 Selon la vitesse, le type de voilier et l’allure par rapport au vent, tel ou tel terme de cette somme peut prendre une importance plus ou moins grande. Les trois premiers termes sont communs à tous les types de navires et représentent l’essentiel de la résistance à l’avancement d’un voilier aux allures portantes. Plus l’allure se rapproche du lit du vent, plus les résistances dues à la gîte et à la dérive s’accroissent. Si l’angle de gîte au près devient excessif, la résistance à l’avancement devient considérable, la finesse de la carène diminue et le voilier «se vautre», selon le terme consacré par l’usage. On comprend mieux ainsi l’importance d’une bonne stabilité, garante de la finesse de la carène à l’allure du plus près.La résistance latérale à l’allure du plus près (portance) de la carène des voiliers modernes pourvus d’un aileron antidérive distinct de la coque provient, pour l’essentiel, de cet aileron. Sur les anciens navires, clippers, cap-horniers, etc., la carène ne comportait aucun aileron antidérive, et la résistance latérale était procurée par une forme adéquate de la carène elle-même.La vitesse et le cap optimalPeut-on concevoir la possibilité d’améliorer indéfiniment la capacité des voiliers à serrer le vent? L’angle de remontée au vent apparent 廓 est directement lié aux finesses de la voilure et de la carène. Il est cependant impossible d’obtenir simultanément les valeurs maximales de ces deux finesses. À mesure que le voilier accélère, la finesse de la voilure augmente, mais celle de la carène diminue.En effet, la portance de la carène est proportionnelle au carré de la vitesse, alors que la résistance à l’avancement croît avec une puissance de la vitesse supérieure à deux; de sorte qu’un voilier rencontre à l’allure du plus près un «mur» de résistance infranchissable, sauf à imaginer un changement radical de conception. Un tel changement a été recherché par l’adaptation des hydrofoils aux voiliers. Diminuer l’angle de remontée au vent paraît donc extrêmement difficile. En revanche, aux allures portantes, un tel phénomène disparaît et il est comparativement plus facile d’augmenter alors la vitesse.La simulation du comportement du voilier aux différentes allures peut être entreprise avec l’aide d’un ordinateur, dès lors que l’on dispose de résultats expérimentaux, essais en bassin ou en vraie grandeur, nécessaires pour «étalonner» le modèle.3. Les recherches actuellesMenées à l’occasion des grandes courses, tout particulièrement de la Coupe de l’America, les recherches actuelles concernent de multiples domaines: formes de carène, structures, voilures, etc. Les conséquences de ces développements profitent, dans une certaine mesure, à la plaisance et à la croisière.Les courses de multicoquesFinancées par les sponsors, les courses de multicoques en solitaire, en double ou en équipage ont pris depuis les années 1980, en France du moins, une importance toute particulière. Amplifiées par les médias, les aventures des skippers et de leurs engins ont intéressé et l’opinion publique et les entreprises désireuses de se faire connaître ou d’améliorer leur image.Pour vaincre ou, parfois même, seulement attirer l’attention, skippers, architectes et chantiers rivalisent d’idées, d’innovations, de hautes technologies, etc. La construction en alliage d’aluminium est abandonnée au profit de structures en matériaux composites à hautes performances: verre unidirectionnel, carbone ou Kevlar. Les voilures traditionnelles sont remplacées par des voiles à grand rond de chute supportées par des «mâts-ailes» pivotants et inclinables. Les coques sont munies de foils (ailerons immergés) destinés à leur donner une portance à grande vitesse. Ces engins, dont le contenu technologique ne cesse de s’accroître, sont aujourd’hui les «formules 1» de la mer. S’ils sont fragiles, leur vitesse fait rêver: 20 nœuds de moyenne sur la Méditerranée, 25 nœuds assez fréquemment.La propulsion éolienne des grands naviresLors des dernières crises pétrolières, les voilures non traditionnelles ont connu un certain succès. En effet, les grands navires à voiles envisagés pour économiser le pétrole requièrent des forces propulsives importantes, c’est-à-dire de très grandes surfaces de voilure, peu compatibles avec les problèmes d’encombrement, de manœuvre et d’équipage réduit, des grands navires de commerce.Sur une idée originale du professeur Lucien Malavard et d’un de ses élèves, B. Charrier, l’équipe Cousteau a développé un nouveau dispositif de propulsion éolienne. Cette «turbo voile», constituée d’un cylindre profilé, crée, grâce à un dispositif interne de ventilation et de contrôle de la couche limite, un champ de pression dissymétrique et donc une portance. Deux prototypes ont été construits sur ce principe, dont l’un, Alcyone, est toujours utilisé par l’équipe Cousteau et navigue depuis 1986. Ce système présente des avantages certains sur une voilure traditionnelle: encombrement réduit, manœuvres automatiques, excellentes caractéristiques aérodynamiques.Cependant, la baisse du prix du pétrole dans les années 1980 a empêché le développement de ce type de propulsion.Par ailleurs, dans une optique de croisière, de grands paquebots à voiles ont été développés, notamment par les Ateliers et chantiers du Havre. Ces navires sont équipés de voilures traditionnelles mais entièrement automatisées. Le spectacle de ces mâtures et voilures constitue un argument commercial important. Cela d’autant plus que des surfaces de voiles modestes, et des systèmes de stabilisation très puissants, réduisent pratiquement la gîte à zéro, et permettent donc un bon confort. Il est probable que de nouvelles réalisations de ce type verront le jour, soit paquebots à voiles modernes, soit «remake» d’anciens clippers... L’engouement pour les voilures classiques domine l’intérêt pour les raffinements techniques des voilures non conventionnelles.
Selon la vitesse, le type de voilier et l’allure par rapport au vent, tel ou tel terme de cette somme peut prendre une importance plus ou moins grande. Les trois premiers termes sont communs à tous les types de navires et représentent l’essentiel de la résistance à l’avancement d’un voilier aux allures portantes. Plus l’allure se rapproche du lit du vent, plus les résistances dues à la gîte et à la dérive s’accroissent. Si l’angle de gîte au près devient excessif, la résistance à l’avancement devient considérable, la finesse de la carène diminue et le voilier «se vautre», selon le terme consacré par l’usage. On comprend mieux ainsi l’importance d’une bonne stabilité, garante de la finesse de la carène à l’allure du plus près.La résistance latérale à l’allure du plus près (portance) de la carène des voiliers modernes pourvus d’un aileron antidérive distinct de la coque provient, pour l’essentiel, de cet aileron. Sur les anciens navires, clippers, cap-horniers, etc., la carène ne comportait aucun aileron antidérive, et la résistance latérale était procurée par une forme adéquate de la carène elle-même.La vitesse et le cap optimalPeut-on concevoir la possibilité d’améliorer indéfiniment la capacité des voiliers à serrer le vent? L’angle de remontée au vent apparent 廓 est directement lié aux finesses de la voilure et de la carène. Il est cependant impossible d’obtenir simultanément les valeurs maximales de ces deux finesses. À mesure que le voilier accélère, la finesse de la voilure augmente, mais celle de la carène diminue.En effet, la portance de la carène est proportionnelle au carré de la vitesse, alors que la résistance à l’avancement croît avec une puissance de la vitesse supérieure à deux; de sorte qu’un voilier rencontre à l’allure du plus près un «mur» de résistance infranchissable, sauf à imaginer un changement radical de conception. Un tel changement a été recherché par l’adaptation des hydrofoils aux voiliers. Diminuer l’angle de remontée au vent paraît donc extrêmement difficile. En revanche, aux allures portantes, un tel phénomène disparaît et il est comparativement plus facile d’augmenter alors la vitesse.La simulation du comportement du voilier aux différentes allures peut être entreprise avec l’aide d’un ordinateur, dès lors que l’on dispose de résultats expérimentaux, essais en bassin ou en vraie grandeur, nécessaires pour «étalonner» le modèle.3. Les recherches actuellesMenées à l’occasion des grandes courses, tout particulièrement de la Coupe de l’America, les recherches actuelles concernent de multiples domaines: formes de carène, structures, voilures, etc. Les conséquences de ces développements profitent, dans une certaine mesure, à la plaisance et à la croisière.Les courses de multicoquesFinancées par les sponsors, les courses de multicoques en solitaire, en double ou en équipage ont pris depuis les années 1980, en France du moins, une importance toute particulière. Amplifiées par les médias, les aventures des skippers et de leurs engins ont intéressé et l’opinion publique et les entreprises désireuses de se faire connaître ou d’améliorer leur image.Pour vaincre ou, parfois même, seulement attirer l’attention, skippers, architectes et chantiers rivalisent d’idées, d’innovations, de hautes technologies, etc. La construction en alliage d’aluminium est abandonnée au profit de structures en matériaux composites à hautes performances: verre unidirectionnel, carbone ou Kevlar. Les voilures traditionnelles sont remplacées par des voiles à grand rond de chute supportées par des «mâts-ailes» pivotants et inclinables. Les coques sont munies de foils (ailerons immergés) destinés à leur donner une portance à grande vitesse. Ces engins, dont le contenu technologique ne cesse de s’accroître, sont aujourd’hui les «formules 1» de la mer. S’ils sont fragiles, leur vitesse fait rêver: 20 nœuds de moyenne sur la Méditerranée, 25 nœuds assez fréquemment.La propulsion éolienne des grands naviresLors des dernières crises pétrolières, les voilures non traditionnelles ont connu un certain succès. En effet, les grands navires à voiles envisagés pour économiser le pétrole requièrent des forces propulsives importantes, c’est-à-dire de très grandes surfaces de voilure, peu compatibles avec les problèmes d’encombrement, de manœuvre et d’équipage réduit, des grands navires de commerce.Sur une idée originale du professeur Lucien Malavard et d’un de ses élèves, B. Charrier, l’équipe Cousteau a développé un nouveau dispositif de propulsion éolienne. Cette «turbo voile», constituée d’un cylindre profilé, crée, grâce à un dispositif interne de ventilation et de contrôle de la couche limite, un champ de pression dissymétrique et donc une portance. Deux prototypes ont été construits sur ce principe, dont l’un, Alcyone, est toujours utilisé par l’équipe Cousteau et navigue depuis 1986. Ce système présente des avantages certains sur une voilure traditionnelle: encombrement réduit, manœuvres automatiques, excellentes caractéristiques aérodynamiques.Cependant, la baisse du prix du pétrole dans les années 1980 a empêché le développement de ce type de propulsion.Par ailleurs, dans une optique de croisière, de grands paquebots à voiles ont été développés, notamment par les Ateliers et chantiers du Havre. Ces navires sont équipés de voilures traditionnelles mais entièrement automatisées. Le spectacle de ces mâtures et voilures constitue un argument commercial important. Cela d’autant plus que des surfaces de voiles modestes, et des systèmes de stabilisation très puissants, réduisent pratiquement la gîte à zéro, et permettent donc un bon confort. Il est probable que de nouvelles réalisations de ce type verront le jour, soit paquebots à voiles modernes, soit «remake» d’anciens clippers... L’engouement pour les voilures classiques domine l’intérêt pour les raffinements techniques des voilures non conventionnelles.
Encyclopédie Universelle. 2012.
